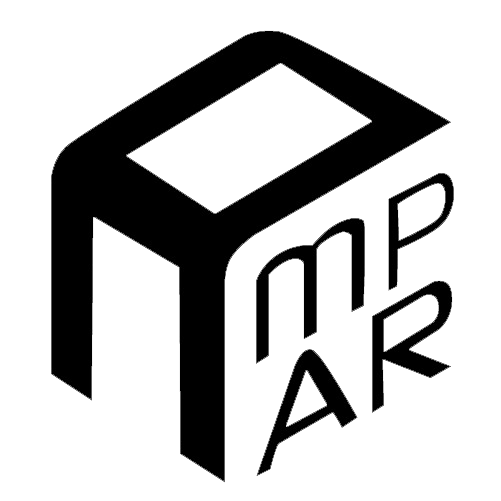Samedi 8 août 2022
Nous rencontrons João Pedro Rodrigues au festival de Locarno, où nous étions venus présenter Poitiers de Jérôme Reybaud, co-produit par l’AMPAR. Le réalisateur est un habitué, couronné du prix de la mise en scène en 2016 pour L’Ornithologue. Il est venu cette année présenter en avant-première son dernier film, Onde fica esta rua ? ou Sem antes nem depois, peu de temps après la projection de son Feu Follet à Cannes, en mai.
Après quelques échanges de mails où il se montre bien plus arrangeant que son attachée de presse, nous convenons d’un rendez-vous à la terrasse du casino de Locarno, où il se prête au jeu du press junket. Il est accompagné par son compagnon et directeur artistique, João Rui Guerra da Mata, ainsi que par l’actrice Isabel Ruth. Nous sommes d’ailleurs un peu embarrassés de dire à celle-ci, dont le CV en fait un équivalent portugais de Catherine Deneuve, que nous n’avons pas vraiment de questions à lui poser ; pas vexée, elle en profite pour s’éclipser dans le casino (nous ne saurons pas si nous lui avons porté chance).
Nous nous apprêtons donc à commencer l’interview quand un employé dudit casino nous indique qu’il nous faut débarrasser les lieux puisque la terrasse va fermer. L’attachée de presse, assise un peu plus loin, fuit notre regard et s’échappe vite ; nous partons donc à la recherche d’un nouveau lieu propice à la discussion, et jetons notre dévolu sur un banc du Giardini Rusca, parc avoisinant qui serait tout à fait charmant s’il n’était pas régulièrement longé par des motos assourdissantes. João Pedro Rodrigues parle un français impeccable, mais nous optons pour l’anglais eu égard à João Rui Guerra da Mata, pour lui laisser la possibilité d’intervenir s’il le souhaite.
Pourriez-vous résumer votre carrière en 5 mots ?
(rires) Je ne saurais pas répondre à cette question…
Ou 5 lieux, si vous préférez !
Ou 5 films ?… Ça, je peux peut-être.
1. Le Berger (1988)
Mon film de fin d’études (ndlr : à l’Ecole supérieure de théâtre et de cinéma de Lisbonne), auquel j’ai un rapport plutôt émotionnel, car je suis passé à autre chose depuis.
2. Happy Birthday (1997)
Mon premier « vrai » court métrage – plus professionnel, en tout cas, même s’il n’a pas été tourné dans un cadre strictement professionnel.
3. O Fantasma (2000)
Mon premier long métrage.
4 et 5. Feu Follet (2022) et Onde fica esta rua ? ou Sem antes nem depois
Mes deux derniers films (ndlr : Onde fica… était justement présenté à Locarno cette année).
Qu’est-ce qu’être réalisateur signifie et représente, à vos yeux ?
J’ai d’abord voulu être ornithologue et ai étudié la biologie ; mais dès mes 15 ans, j’ai commencé à aller souvent au cinéma. J’ai tendance à faire les choses de façon obsessionnelle, et c’est devenu une obsession ; donc quand je suis arrivé en biologie à l’université, en réalité, je savais déjà que ce n’était pas ce que je voulais faire. J’avais déjà une pensée un peu scientifique, mais j’ai été déçu par mes collègues de fac en biologie, qui étaient des gens très carrés, intéressés seulement par leurs notes. L’école de cinéma était en travaux à l’époque, mais j’ai passé le concours dès qu’elle a rouvert.
Je n’ai pas commencé à faire des films directement quand j’en suis sorti. J’ai d’abord été assistant réalisateur et monteur pendant une dizaine d’années. C’était très important pour moi d’attendre avant de faire mon premier film, à l’âge de 30 ans, et j’en suis très heureux.
En quoi votre expérience d’assistant réalisateur a-t-elle influencé votre travail ?
J’ai principalement été second, et j’ai plutôt travaillé sur de bons films, jamais à la télé ou sur des publicités. Je pense y avoir appris ce qu’il ne fallait pas faire plus que ce qu’il fallait faire : en tant que réalisateur, on est le chef d’une équipe et tout dépend de vous. J’ai toujours été soucieux de tout contrôler, alors j’ai appris à déléguer. J’ai commencé avec de très petites équipes : nous étions seulement 4 pour mon premier court métrage, dont Joao Rui qui s’occupait aussi des décors et de la
direction artistique, et tout a été filmé dans notre appartement. Cela me permettait de garder la main sur tout : je ne crois pas du tout en l’improvisation.
Une autre chose que j’ai apprise : je n’avais aucune envie de travailler sur les films des autres.
Pourriez-vous nous donner des exemples précis de ce que vous avez voulu ne pas reproduire ?
C’est difficile de le dire précisément, mais j’ai par exemple voulu commencer à faire jouer des amateurs. J’ai été inspiré en cela par Bresson, que j’aime particulièrement. Les acteurs sont trop… compliqués – dans les films sur lesquels je travaillais, en tout cas. Ils exigeaient des réponses que je ne sentais pas pouvoir leur donner, parce que ça ne correspondait pas à ce que je cherchais en tant que cinéaste. Ils demandent à être dirigés sur le plan de la psychologie, alors que je ne donne pas vraiment ce genre d’indications : je préfère me concentrer sur le côté purement physique.
Je me suis plus tard rendu compte qu’en excluant les comédiens professionnels, j’« appauvrissais » mon cinéma, et que c’était aussi de la peur de ma part. J’ai découvert qu’il fallait tourner avec toutes sortes de profils, mais surtout s’arranger pour trouver la bonne personne pour un rôle, qu’elle soit amatrice ou professionnelle : quelqu’un qui soit en cela irremplaçable et sans qui je ne pourrais pas faire le film. C’est souvent très difficile, mais il y a quelque chose de miraculeux quand le comédien devient, d’une certaine manière, le personnage que j’imaginais. J’écris le scénario en pensant à la façon dont il se meut, dont il parle… Ils ne sont pas le personnage, mais le personnage vient d’eux.
Etes-vous aussi précis lorsqu’il s’agit de choisir vos techniciens ?
Je suis très chanceux de les avoir trouvés dès mon premier film ! Ça a toujours été les mêmes depuis et je n’ai pas envie de travailler avec d’autres. Pour O Fantasma, qui a été tourné en 35mm, nous n’étions que 10. Cela me permettait de garder la mainmise sur tous les aspects du film.
Cela me permet de rebondir sur votre question précédente, sur ce que j’ai voulu ne pas reproduire : quand je travaillais avec d’autres réalisateurs, je trouvais toujours qu’il y avait trop de personnes sur le plateau. On en voit toujours qui bossent 5 minutes, puis qui attendent pendant 3 heures : que font ils là ? Ce travail ne peut-il pas être fait par quelqu’un d’autre, qui est aussi en train d’attendre à ce moment-là ? La hiérarchie est évidemment importante, mais il faudrait plus de fluidité, que les gens n’aient pas à remplir une unique tâche. J’ai travaillé avec toutes sortes de budgets différents – bon, ça ne se comptait tout de même pas en millions… – et je n’ai jamais compris, alors que le cinéma est une industrie si couteuse, pourquoi les techniciens étaient payés si chers. En tant que réalisateur, je veux que l’argent aille dans le côté artistique de ce que j’ai envie de produire, surtout au Portugal où nous travaillons dans une économie très restreinte. La question est : comment employer cet argent pour faire le meilleur film possible, et pas simplement pour payer des salaires.
Aujourd’hui, les producteurs ont tendance à réduire de plus en plus les temps de tournage : comment voulez-vous tourner un long métrage en 4 semaines ? C’est impossible, ou presque – on se débrouille toujours pour s’en sortir. Je veux faire plein de prises, plein de répétitions, et avoir la possibilité de tourner à nouveau des séquences que je n’aurais pas réussies du premier coup.
Faire un film, c’est toujours contourner les contraintes du budget. Ce que je recherche, c’est la liberté artistique.
Qu’attendez-vous de votre assistant réalisateur, quand il s’agit justement de soulager cette pression ?
C’est toujours moi qui impose le rythme du tournage. Tout est découpé, et je sais précisément ce que je dois tourner chaque jour. Parfois, je fais de petits ajustements en début de journée en me réunissant avec les acteurs et le chef opérateur, mais en général je sais combien de plans j’ai à faire et de combien de temps je dispose pour chacun. Je reste toujours près de la caméra, même pendant les installations lumière, parce que je déteste être assis. Je sais aussi que ma seule présence impose un rythme. Si je sens qu’on est en retard, j’essaie de compenser au fur et à mesure en trouvant des alternatives. Je ne tourne jamais une scène sous plusieurs angles : c’est toujours un plan après l’autre. L’autre jour, en parlant avec Bernard Eisenschitz du film de Douglas Sirk que je devais présenter (ndlr : dans le cadre de la rétrospective intégrale de l’œuvre de ce dernier), je me suis rendu compte que je fonctionnais comme lui : il tournait avec le montage en tête, et il n’avait pas vraiment d’autre possibilité d’enchaînements des plans une fois arrivé en post-production. C’est une stratégie habituelle chez les grands réalisateurs hollywoodiens, qui n’avaient pas le droit au final cut. Je pars de toute façon du principe qu’il n’y a qu’une seule façon de tourner une scène, et mon métier est de la trouver.
Quelles sont pour vous les qualités essentielles d’un premier assistant réalisateur ?
La débrouillardise. La concentration. La patience.
J’entretiens une relation de confiance avec mon assistant, Paulo Guillherme. Il doit être du côté du réalisateur, parce que c’est aussi lui qui fait le lien avec la production, qui essaie d’ailleurs toujours de le séduire et de l’attirer de son côté. J’ai eu une bonne relation avec les producteurs de mes deux derniers films, mais ça n’a pas toujours été le cas. Ce conflit entre réalisateur et producteur est normal, voire bénéfique dans une certaine mesure, mais ça peut dériver vers le malsain dans certains cas.
C’est-à-dire ?
Je parle de mon film L’Ornithologue (2016). Mes producteurs ont carrément tenté de boycotter le film et de m’empêcher de tourner. Il y avait des problèmes de budget, et s’ils arrivaient à prouver que je n’arrivais pas à faire avancer le tournage, ils auraient une bonne raison d’interrompre la production. Ça a fini au tribunal, c’était vraiment horrible.
Auriez-vous des exemples de situations où l’influence de votre assistant s’est particulièrement fait ressentir (en bien ou en mal) ?
Je pars du principe que c’est moi qui prends toutes les décisions. Evidemment, je discute avec mes collaborateurs, mais mes films correspondent finalement à mon idée originelle et mon point de vue sur la vie et le monde. Ce n’est pas autobiographique, mais c’est personnel. Si je faisais O Fantasma aujourd’hui, il serait sans doute très différent du film que j’ai réalisé à mes débuts.
Le travail d’un premier assistant avec moi est très focalisé sur l’organisation et le plan de travail. Avec Feu Follet, pour la première fois, je n’ai pas jeté le moindre plan une fois arrivé en salle de montage. C’est sans doute dû au long temps de préparation dont j’ai pu bénéficier, à cause de la pandémie. Je ne pouvais pas m’arrêter de travailler : la réalisation est bien sûr un métier, mais c’est tellement entremêlé avec ma vie intime que j’ai toujours tendance à vouloir travailler plus. Les heures supplémentaires posent évidemment des questions budgétaires, mais je vis vraiment très mal de devoir interrompre mon travail seulement parce que mon équipe a besoin de se reposer. Je ne sais pas d’où vient cette énergie, c’est presque une défonce.
Vos films mettent régulièrement en scène du contenu sexuel cru et explicite. Quel est votre point de vue sur la nouvelle profession de coordinateur d’intimité, qui est en train de voir le jour ?
J’ai appris l’existence de ce poste très récemment, à Cannes, quand quelqu’un m’a demandé s’il y en avait sur mes plateaux. J’essaie de construire une relation de confiance avec mes acteurs, ce qui demande beaucoup de préparation : je ne leur demande pas simplement d’enlever leurs habits une fois qu’ils sont arrivés sur le décor ! Tout est très répété, et je considère que les scènes de sexe relèvent de la même banalité que le reste. Bien sûr, il y a de la tension dès qu’on parle d’intimité et de nudité – à part à vivre dans un camp de nudistes –, mais j’essaie de ne pas hiérarchiser. Ca reste du travail, et quand on travaille, on travaille : même si je me sens proche de mes comédiens, une distance s’instaure. Je ne suis pas du genre à crier, comme j’ai vu certains réalisateurs le faire quand le pouvoir leur monte à la tête. Je ne crois pas abuser de ma position, si ? (il se tourne vers João Rui Guerra da Mata, qui fait non de la tête). J’ai pu parfois me sentir anxieux et hausser la voix sur les membres de l’équipe, mais je m’efforce toujours de rendre l’expérience plaisante pour les autres et moi-même, même quand ça devient très intense et stressant.
Comment décririez-vous un plateau de tournage à quelqu’un qui n’en n’a jamais vu ?
Il y a des acteurs, une caméra, des projecteurs… Je le décrirais d’une façon très concrète : tout le monde travaille avec un objectif artistique en tête, mais ça reste du travail. Je n’ai pas vraiment de réponse métaphorique à donner, je préfère répondre comme John Ford le ferait : il y a des gens derrière la caméra, il y a des gens devant la caméra, et c’est tout ! Je pense que quand on conceptualise trop, on se retrouve avec finalement pas grand-chose.
Suivez-vous des rituels avant de filmer ?
J’essaie de bien dormir. Je ne peux pas réfléchir correctement si je ne suis pas reposé, alors après chaque journée de tournage, je mange en vitesse et je vais au lit. J’ai souvent besoin de prendre des somnifères à cause de l’adrénaline.
C’est sans doute parce que je suis anxieux à l’idée de rater quelque chose qui ne se reproduira pas. Jusqu’ici, ça m’a plutôt réussi puisque je ne regrette aucun de mes films, même si je ne les revois jamais parce que je préfère aller de l’avant.
Auriez-vous des exemples d’expériences de tournage particulièrement positive ou négative ?
On a déjà parlé du mauvais, c’était le tournage de L’Ornithologue. Je me sentais méprisé par la production. C’était traumatisant, violent, je n’avais jamais vu ça. C’était complètement insensé parce que c’était aussi leur film, mais ils ne sont même pas venus pour la présentation à Locarno : mon agent a dû payer nos billets !
Au contraire, Feu Follet a été une expérience très joyeuse. Nous avions un budget très restreint et le film n’est pas très long (seulement 67 minutes), donc le tournage n’a duré que 2 semaines et 2 jours. Je n’avais jamais tourné aussi vite, mais j’ai tout de même pu faire 8 ou 10 prises par plan.
Quelle est la question qu’on ne vous a jamais posée à laquelle vous rêvez de répondre ?
Je ne suis pas fan des interviews en général. Je rêve plutôt qu’on ne m’en pose pas !
Mercredi 7 septembre 2022
Plus sadiques encore que le protagoniste d’O Fantasma, nous lui proposons malgré tout une nouvelle rencontre, cette fois-ci à Poitiers, juste avant la projection en avant-première de Feu Follet au Dietrich. L’occasion de poursuivre notre conversation, cette fois-ci sans João Rui Guerra da Mata, mais avec les étudiants de la promo 2021-2023 qui n’ont pas pu venir à Locarno.
Le film que vous présentiez au festival de Locarno, Onde fica esta rua ?…, est directement inspiré de Les Années vertes de Paulo Rocha, qui a été votre professeur. Pensez-vous qu’il y a un « esprit » de l’école de Lisbonne ?
Je ne suis plus vraiment en contact avec cette école, surtout parce que ceux qui la tenaient quand j’y étudiais sont tous morts. Il y avait surtout Paulo Rocha et Antonio Reis, deux des plus grands réalisateurs portugais de l’après-guerre, mais aussi Jorge Silva Melo. J’ai cofondé une compagnie de théâtre avec lui, juste après avoir été premier assistant sur son film Pauvre Georges ; mais j’ai vite compris que le théâtre n’était pas pour moi.
Ils n’appartenaient pas vraiment à une nouvelle vague, mais à ce qu’on appelle le cinema novo (même si Reis est un cinéaste très particulier). Ils faisaient partie des mouvements étudiants qui se sont soulevés contre la dictature alors en place.
On sent un fort aspect documentaire dans un film comme L’Ornithologue : les séquences qui en relèvent le plus directement avaient-elles une place à part pendant le tournage ?
Je n’ai jamais exercé l’ornithologie à titre professionnel, mais je garde toujours sur moi des jumelles. Mon père m’en a offert une paire quand j’avais 8 ans et ça m’a passionné de me promener seul dans la campagne, pour classifier tous les oiseaux de ma région natale, à 2 heures au Nord de Lisbonne. Je savais donc comment observer les oiseaux sauvages, mais on ne peut jamais savoir quelles espèces on va filmer, exactement, ni si on les aura de près, de loin… J’avais déjà écrit le scénario, mais j’ai filmé les oiseaux avant le reste à quelques exceptions près : le hibou, la chouette ou la colombe, par exemple, étaient entraînés.
J’ai tourné ces plans d’oiseaux sur la rivière pendant 3 semaines, puis encore un peu l’année suivante ; entretemps, j’ai postulé à la bourse du Ratcliffe Institute de l’université de Harvard, qui m’a permis de passer l’année à visionner tout le matériel que j’avais filmé et à réécrire le film en fonction. Les oiseaux que j’ai saisis et la façon dont je les ai captés ont façonné le film : il fallait que les contrechamps paraissent cohérents dans l’espace, donc ils imposaient certains choix.
Il y a toujours un côté documentaire dans mes films, dans le sens où tout part toujours du réel. Je fais toujours des recherches sur mes sujets et les professions de mes personnages, avant et pendant l’écriture. Pour O Fantasma, j’ai passé 6 mois à suivre des éboueurs 2 fois par semaine, ce qui a beaucoup nourri le film – qui est par ailleurs une complète fiction. C’était important de partir du réel pour arriver à quelque chose de presque fantastique. Je dis souvent que mes films sont des documentaires, mais c’est parce qu’ils sont toujours des portraits des lieux que je filme au moment où je les filme.
Réfléchissez-vous déjà à la post-production pendant le tournage ?
Tout est décrit précisément dans mes scénarios : je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas faire de storyboard, mais je fais en sorte que mon lecteur puisse voir le film. J’écris beaucoup de versions, mais je sais exactement ce que je vais filmer quand j’arrive aux dernières, juste avant le tournage. Je suis de l’avis qu’il ne faut pas tricher devant les commissions, alors je ne fais pas de « fausses » versions exprès pour leur plaire. Ecrire les sentiments et les états d’âme sur papier ne m’intéresse pas vraiment, donc je demande parfois à quelqu’un de réécrire un peu dans ce sens, mais je ne veux pas trop diriger les sentiments du lecteur : je pense que c’est quelque chose qui se trouve avec les acteurs, et décrire juste par une émotion est souvent réducteur. Un scénario se doit d’être descriptif, il y a une sécheresse spécifique qui n’est pas du tout littéraire. Les descriptions très exhaustives sont parfois fastidieuses, alors il faut trouver le juste équilibre pour que ça se lise rapidement et fluidement, plus vite qu’on lirait un roman, en tout cas.
Comment travaillez-vous avec vos acteurs ?
Je fais énormément de répétitions et je dirige mes comédiens très précisément, mais je cherche toujours quelque chose qui me surprenne, qui arrive par hasard ; à ce moment-là, on suit ce quelque chose, et ça détourne la scène vers une direction à laquelle je ne m’attendais pas. Quand on tourne, il y a une tension qui ne peut pas advenir avant. Ca m’arrive d’être déçu d’une scène que j’ai tournée et de vouloir la refaire, mais c’est très dur de retrouver cette tension, de retrouver ce que les acteurs ont sorti – c’est particulièrement terrible quand il y a des problèmes de caméra ou de labo avec la pellicule.
Comment choisissez-vous vos acteurs ?
Dans le cas de Paul Hamy, je cherchais un cowboy dans le genre de James Stewart ou Randolph Scott, un héros qui ne parle pas beaucoup, avec un visage très particulier mais une certaine douceur, et je n’en trouvais pas au Portugal. Mon producteur français m’a parlé de Paul, on s’est rencontrés et on s’est bien entendus.
Odete (2005) semble s’inscrire assez clairement dans un autre genre très codifié, le mélodrame. Comment avez-vous abordé cette inscription dans une branche précise de l’histoire du cinéma ?
J’ai appris à faire des films en voyant d’autres films, et j’en vois toujours beaucoup, mais j’essaie toujours de ne pas m’en inspirer directement. J’ai appris ces codes du cinéma américain classique, mais je ne les utilise pas en me disant « là, je vais faire comme untel » : j’essaie de le faire le plus naturellement possible.
C’est vrai qu’il y a du mélodrame dans Odete, mais aujourd’hui, ce qu’on appelle les comédies romantiques en sont également souvent. Le mélodrame est à l’origine de beaucoup d’histoires qui se racontent aujourd’hui. J’ai fait une sorte de mélodrame gothique : il y a la présence de la mort, un côté romantique de la littérature du XIXe… C’est quelque chose qui nourrit le film, et tous mes films sont un peu des mélodrames, je pense.
Vous utilisez souvent des plans très larges.
S’il y a des gros plans, c’est qu’il y a une raison de se rapprocher. Je n’aime pas être tout le temps serré, et ça doit avoir un sens de montrer un visage, une main, un pied… à un certain moment. J’aime une certaine distance, une certaine froideur. Je n’aime pas quand un acteur surjoue : je vois qu’il essaie de sortir une émotion, et pour moi rien ne se produit. Pour revenir à Bresson, ça peut être très émouvant et sensuel – pour moi, c’est le réalisateur le plus sensuel qui soit – sans être naturaliste. Je filme la réalité, des gens et des espaces, mais le cinéma n’est pas la réalité : c’est stylisé, inscrit dans un récit, et je ne prétends pas que ce soit la réalité.
Le terme « documentaire » ne veut finalement pas dire grand-chose : ce qui m’intéresse, c’est quand le documentaire est mis en scène. Ça ne veut pas dire que tout est dirigé, mais je ne vois pas beaucoup d’intérêt aux films où la caméra se contente de suivre des gens. C’est aussi très à la mode aujourd’hui de filmer en longue focale. Tout est flou autour, ce que je ne trouve pas très intéressant. Ce que j’aime, c’est l’espace et la façon dont les personnages s’inscrivent dedans, donc j’évite les objectifs qui rendent cet espace invisible. Je filme avec des optiques proches de l’œil humain, j’aime beaucoup le 35mm. J’aime le rendu et le rapport avec les acteurs : pour filmer en 35 ou en 50, il faut se rapprocher. Je filme souvent avec 3 optiques par film, jamais de grand angle. J’ai une idée de ce que ça donne, mais je suis très peu calé en technique, donc ça passe surtout par des discussions avec le chef opérateur.
Il y a un plan très impressionnant dans Mourir comme un homme (2009), où un train passe dans le lointain au moment précis où un personnage se retourne au premier plan. Est-ce une incrustation ?
Non, on a vraiment attendu. Il faut attendre énormément au cinéma, parce que le cinéma, c’est du temps. Quand je pense mes budgets, c’est le temps que je cherche en priorité, parce que je sais que je ne suis pas très rapide.
Travaillez-vous activement à créer un environnement propice au surgissement de l’inattendu ?
Je ne saurais pas répondre à ça… Parfois il y a des choses qui se passent par hasard, et je pars du principe que si ça produit quelque chose en moi, ça le produira peut-être chez quelqu’un d’autre. Tout n’est pas explicable, et j’essaie de ne pas tout rationaliser. Il y a des choses que je sens sans vraiment savoir pourquoi, et j’essaie de ne pas trop me le demander. Je n’aime pas le mot « intuition », qui donne l’impression que ça ne passe pas par le travail.
Pour O Fantasma, j’ai eu une vision – je dis ça de façon caricaturale parce que j’ai visité plein d’églises aujourd’hui – du premier plan avec le chien noir dans le couloir. C’est à partir de là que le film s’est construit, mais j’avais déjà les éboueurs en tête, ces espèces de fantômes de la ville qu’on ne regarde pas, qui sont un peu invisibles parce qu’ils travaillent « à l’envers » de nous. J’aimais cette idée, et je voulais poser la question : « qui sont ces gens ? ». Comme ils font toujours les mêmes trajets, ils finissent par savoir qui habite où, quelle lumière sera encore allumée à 3h du matin, ils savent ce qu’il y aura à récupérer dans les poubelles… Ils en savent plus qu’on ne croit sur les habitants des quartiers, ils ne connaissent pas que les déchets.
Des événements marquants dans vos précédents tournages ?
Sûrement plein, mais j’essaie d’oublier mes films. J’ai cette idée que pour passer à un autre film, il faut abandonner le précédent. Je les connais par cœur, presque plan par plan, mais je ne suis pas du genre à les revoir.
Préférez-vous le numérique ou la pellicule ?
La pellicule, mais je ne peux pas le faire tout le temps (rires). Vous avez encore la chance d’avoir des labos en France, mais il n’y en a plus au Portugal ; il faut envoyer les négatifs à l’étranger, et ça m’angoisse énormément de savoir qu’ils voyagent. Ca impose une discipline, alors qu’en numérique on a cette idée qu’on pourra tout tourner. J’aime la contrainte : il y en a toujours, mais il faut faire le film autour d’elles. C’est aussi purement physique : la pellicule prend la lumière différemment, et il y a une matérialité qui est différente. J’ai fait mon dernier film en 16mm, j’espère pouvoir faire le prochain en 35mm.
Quelle est votre phase préférée de la production de vos films ?
Le tournage. Je n’écris jamais seul parce que je suis paresseux, et je sens qu’être avec les autres me force à travailler. Le tournage est ultra angoissant, mais c’est vraiment là que le film se fait : ce n’est pas au montage qu’on pourra le sauver. Le montage est une confirmation de ce qui a été fait au tournage.